Il faut se défaire d’une caricature. La France de Napoléon III n’est pas celle d’une fête malsaine, ordonnancée par les « lionnes » du demi-monde et des hommes de pouvoir et d’affaires corrompus. Ni l’insouciance de La Grande Duchesse de Gérolstein ou de La Vie parisienne de Jacques Offenbach ni le désespoir héréditaire qui hante les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire, d’Emile Zola ne peuvent seuls tenir lieu de bilan. Les dates terribles du coup d’état du 2 décembre 1851 et du désastre de Sedan, le 2 septembre 1870, cachent l’histoire d’un règne qui ne saurait être réduit à celui de Badinguet - surnom donné à l’empereur Napoléon III par ses ennemis politiques, qui lui vient du nom du maçon qui, en prêtant ses vêtements au prince Louis Napoléon qu’il était alors, lui permit de s’évader du fort de Ham en 1846. Il faut encore se défaire de l’image d’Epinal composée par les proscrits de l’Empire qui comptent les plus grandes figures républicaines comme Louis Blanc, Edgar Quinet ou Barbès et d’importants écrivains comme Eugène Sue ou Alexandre Dumas. Les mots de Victor Hugo, peu après le 15 août 1859 où Napoléon III proclame une amnistie sans condition pour tous les proscrits, « Fidèle à l’engagement que j’ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu’au bout l’exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai » résonnent encore. La condamnation de « cette baraque, abject et vil bazar, où Mandrin mal lavé se déguise en César » que lance le même Victor Hugo ne suffit pas à dire ce que fut le second Empire.
Lorsque l’empire prend place, la France est encore un pays essentiellement agricole. Les techniques qui permettent de nourrir et d’occuper une population rurale, au sein de laquelle le nombre de travailleurs agricoles n'a jamais été aussi important que dans les années 50 et 60, sont celles héritées du XVIIIe siècle. Si la traction demeure animale, une agriculture qui a recours à des machines simples nécessitant moins de main-d’œuvre se met en place ; le battage des céréales, par exemple, commence d’être mécanique ; à l’Exposition universelle de 1855, une trentaine de machines à semer est présentée. Dans le même temps on commence à utiliser des engrais, en particulier le guano. La généralisation de la culture de la pomme de terre conjure la hantise des famines. Les surfaces où l’on cultive la betterave à sucre augmentent de quelque 50 % dans les départements du nord de la France. Parce que le Grand Dictionnaire du XIXe siècle donne en 1867 pour définition du mot « ouvrier », « une personne qui gagne sa vie à travailler de ses mains », les statistiques de la même époque comptent sans doute parmi les « ouvriers » un certain nombre de ceux qui travaillent à la transformation de ces betteraves sucrières. Ceci ne masque pas une évidence : dans une France qui compte 38 millions d’habitants en 1866, 11 millions de Français vivent de « professions industrielles ». En moins de vingt ans, la population d’ouvriers actifs, qui n’était que d’à peine un million et demi à la veille de la révolution de 1848, a pratiquement doublé. Plus de la moitié de ces ouvriers travaillent dans l’industrie du textile et de l’habillement. C’est dans ce domaine que la prolétarisation est la plus forte. Le bâtiment est le deuxième plus important employeur du monde ouvrier. La population ouvrière n’est encore majoritaire en 1866 que dans deux départements, le Nord et la Seine. Mais le prolétariat de ces départements ou d’un centre minier comme le Creusot (où la population atteint 24 000 habitants en 1866, alors qu’elle n’était que de 1 200 habitants en 1832) n’est pas représentatif de l’immense majorité de ceux qui constituent le monde ouvrier. Le secteur artisanal, au sein duquel un patron dirige en moyenne trois ouvriers, assure encore 70 % de la production du pays. Les machines à coudre, les scies mécaniques, les premières machines-outils qui font leur apparition commencent de modifier le rapport des ouvriers à leur travail. « Le spécialiste a tué l’artiste » se plaignent alors des rapports ouvriers. Seuls à peine 10 % des ouvriers parisiens parviennent à travailler moins de douze heures par jour. Dans les filatures de Roubaix, la journée commence à 5 h 30 du matin et ne finit qu’à 21 h 30. Elle n’est ponctuée que d’une heure de pause à midi et d’une demi-heure de goûter vers 16 h 30. Peu à peu le salaire hebdomadaire et remplacé par la quinzaine. Ce rythme du versement du salaire a, entre autres raisons, un but moral: il s’agit d’éviter ce que le romancier Alphonse Daudet appelle « l’horrible drame si parisien » que sont les beuveries des samedis de paye. On boit deux fois plus de vin en 1870 à Paris que vingt ans plus tôt. Pendant l’empire, si les salaires augmentent de 30 %, de 40 % dans certaines professions, les disparités de ces augmentations au sein d’une même profession comme entre les hommes et les femmes - une ouvrière est payée presque deux fois moins qu’un ouvrier -, et les augmentations des denrées comme des loyers rongent ces augmentations. A Paris, à peine un peu plus de la moitié des familles ouvrières atteint une aisance toute relative. En 1860, seuls 5 % des ouvriers parisiens qui gagnent 6 francs par jour peuvent prétendre gagner correctement leur vie. Sans avoir la moindre sécurité quant à leur emploi ni pouvoir espérer la moindre retraite. Sans pouvoir être assuré, à Paris, de pouvoir longtemps payer un loyer qui ne cesse d’augmenter. C’est qu’en 1860 Paris annexe onze communes qui sont à l’intérieur de l’enceinte construite en 1840. Et compte 20 arrondissements, que les travaux mis en œuvre par le baron Georges Haussmann bouleversent. Des avenues et des boulevards qui deviennent, selon le poète Alfred de Musset parmi « les lieux les plus agréables du monde », sont percés dans l'écheveau de ruelles étroites aussi insalubres que propices à la construction de barricades. Les travaux, qui modifient de fond en comble la capitale en détruisant les barrières des fermiers généraux, en créant deux axes permettant de traverser la ville du sud au nord par les boulevards Saint Michel, de Sébastopol et de Strasbourg, d’est en ouest par le rue de Rivoli, qui ouvrent des parcs comme celui de Monceau ou de Montsouris, comme le bois de Vincennes à l’est et le bois de Boulogne à l’ouest, sont tout autant une affaire politique que d’hygiène. Comme les égouts sont étendus, le réseau de distribution de l’eau potable passe de 364 kilomètres en 1854 à 1 370 en 1874. Cette métamorphose de la capitale s’accompagne de l’installation de la bourgeoisie dans la ville. Selon Pierre Larousse, le bourgeois est « une personne aisée qui habite la ville ». Un mode de vie et des mœurs caractérisés par la stabilité et l’aisance, mais qui répugne à s’engager dans la passion ou l’héroïsme définit les « bourgeois ». Si le romancier Gustave Flaubert écrit « j’appelle bourgeois tout ce qui pense bassement », il distingue « les bourgeois en blouse » et « les bourgeois en redingote » : la bourgeoisie n’est pas uniforme. Elle compte en premier lieu un groupe qui vit du profit industriel ou commercial sur une base artisanale ou boutiquière, jusqu’au grand négoce, à la banque, à l’usine. Elle compte une bourgeoisie de la rente qui prolonge un idéal aristocratique d’oisiveté, occupée de la gestion de biens, d’activité savantes ou intellectuelles, satisfaite de titres honorifiques comme celui de conseiller général. Enfin elle compte ceux que distinguent des diplômes ou des talents. L’avocat ou le juge, l’officier ou l’artiste sont de ceux-là. Les appartements des uns et des autres commencent d’être éclairés au gaz. Comme le sont les rues et les gares. Le réseau des voies ferrées qui ne compte que près de 3 700 kilomètres en 1852, en compte 17 000 à la fin de l’année 1869. Il n’en est que plus facile de venir à Paris visiter les expositions universelles dont l’architecture du palais des Arts et de l’Industrie, halles de fer construites sur le même principe que les Halles de Baltard, comme de « vastes parapluies » selon l’expression et la volonté de l’empereur lui-même, n’est pas le moindre des attraits. Celle de 1855 draine cinq millions de visiteurs dont la reine Victoria. Sans doute admire-t-elle les œuvres de ceux que les membres de l’Institut ont retenu et dont les tableaux sont exposés sur plusieurs rangs. Ce sont des peintures que certains commencent d’appeler par dérision peintures de « pompiers » parce que les casques coiffés par les héros de l’Antiquité représentés ici et là ressemblent à ceux que portent les pompiers... Si l’empire est le temps où l’esthétique de l’architecture qualifiée d’éclectique (parce qu’elle s’inspire de formes qui viennent de Byzance comme de celles de temples grecs et romains), ou de l’architecture gothique, il est le temps où l’on commence de se soucier du patrimoine, où l’on restaure le Mont-Saint-Michel et Notre-Dame de Paris. Et si, pendant l’empire le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, est condamné comme est condamné le recueil du poète Charles Baudelaire Les Fleurs du mal, en dépit du conformisme moral qui pèse, au prix de scandales, quelques peintres comme Gustave Courbet ou Edouard Manet commencent à peindre des sujets nouveaux. Depuis le quartier du IXe arrondissement de Paris, que l’on appelle la Nouvelle Athènes, rayonne une culture qui fascine le monde.
Méthode du Commentaire de Texte
Savez-vous commenter un texte ou un corpus documentaire ? ?? Un commentaire de texte en français requiert une analyse rigoureuse et approfondie d'un extrait littéraire, poétique ou théâtral. Il doit mettre en lumière les choix stylistiques, les thèmes et les procédés d'écriture de l'auteur. ✍️ Cet exercice exige également une capacité à interpréter le sens[…]
26 February 2024 ∙ 8 minutes de lecture










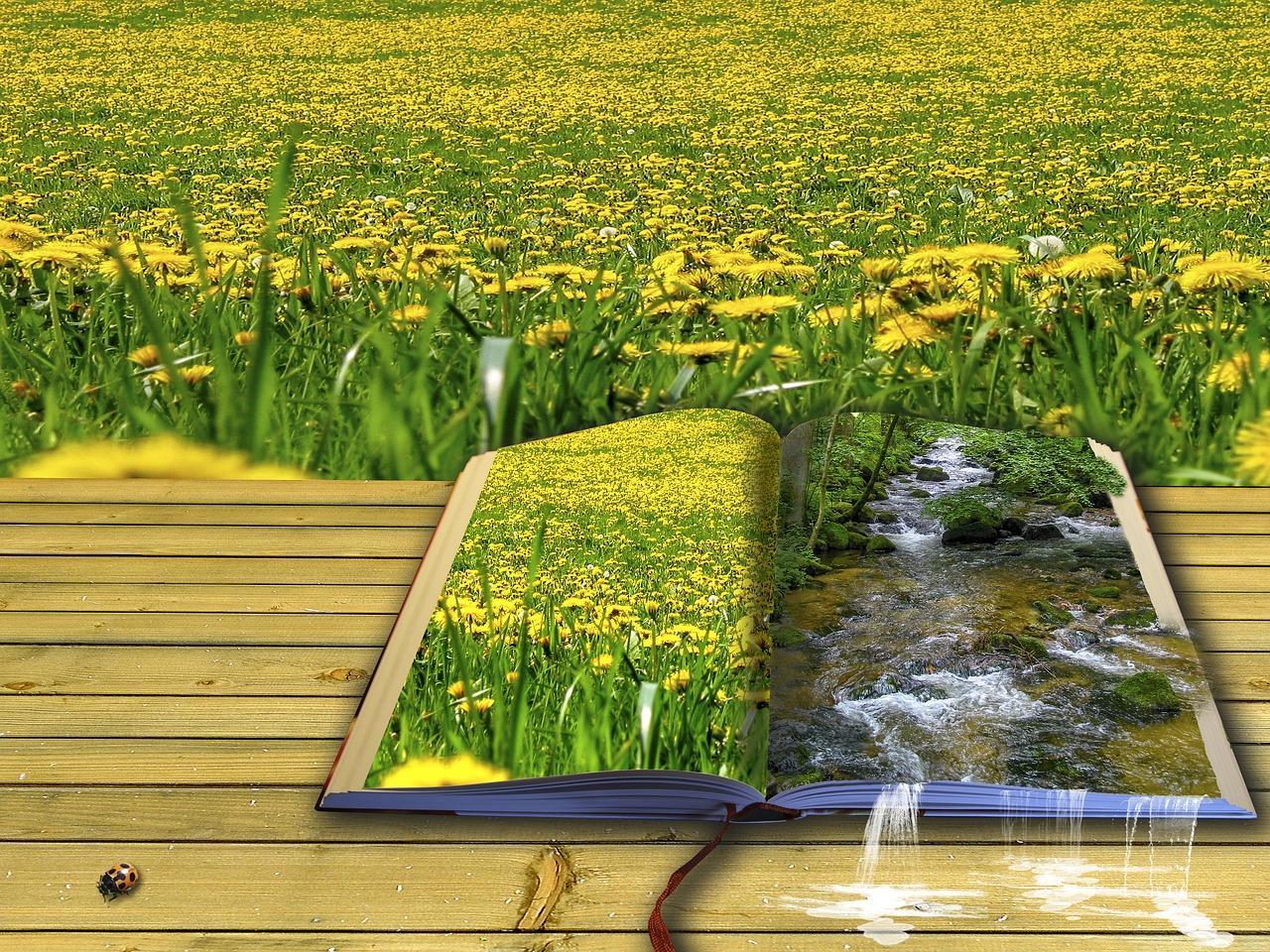
Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !